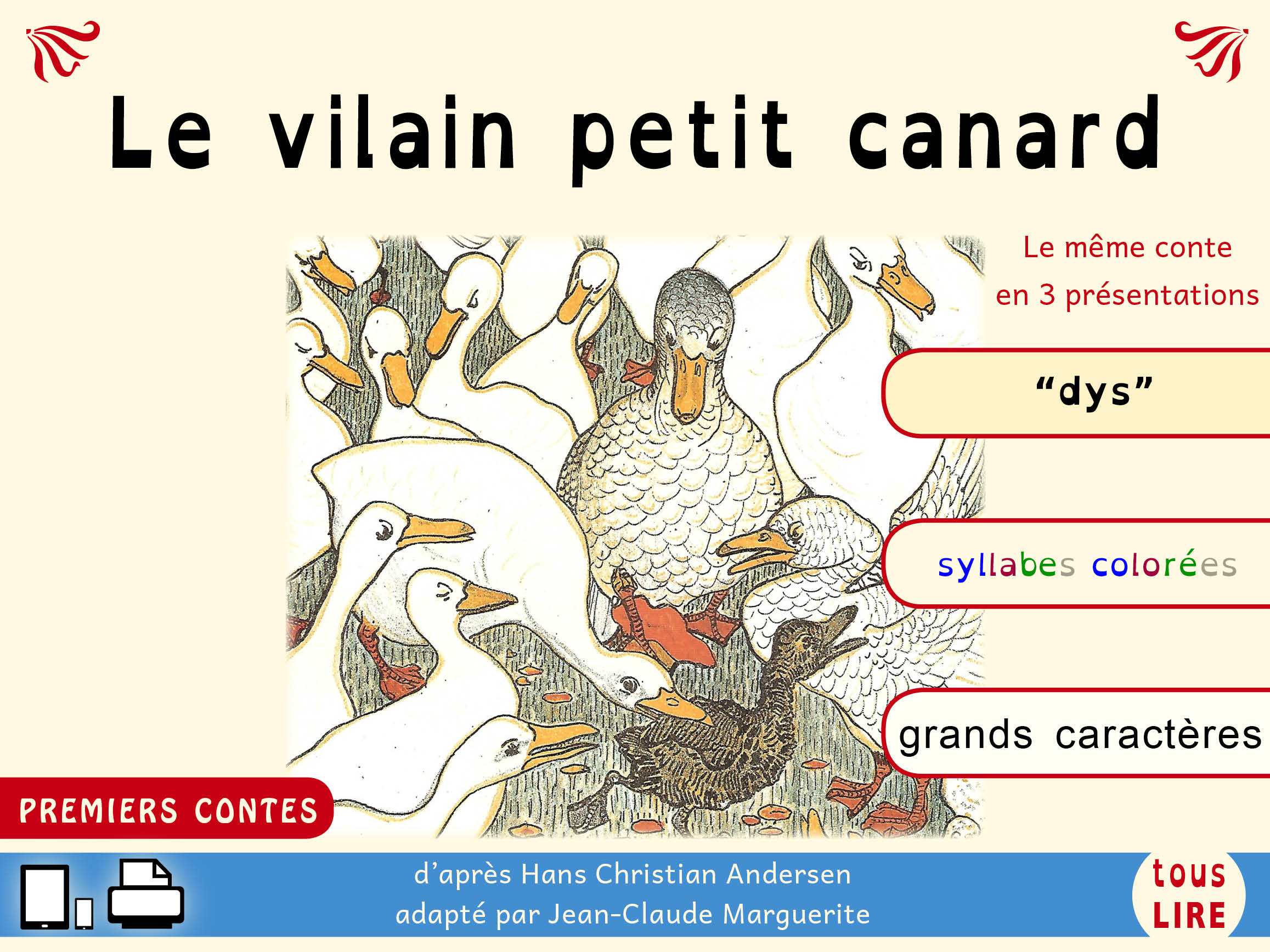Post-face de l’édition numérique gratuite des Contes de ma mère l’Oye, en français d’aujourd’hui, à l’occasion du 326 anniversaire des contes de Perrault.

Le 11 janvier 1697 paraissaient les Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités, dont le second titre, mentionné au dos de l’ouvrage, était Les Contes de ma mère l’Oye. Leur auteur est âgé de 67 ans et signe ce recueil sous le nom d’un de ses fils. Il faut dire que Charles Perrault est un homme de lettres réputé, connu pour être l’adversaire farouche de La Fontaine, Boileau et La Bruyère dans la querelle des Anciens et des Modernes qu’il a initiée. Après un succès éphémère auprès d’un public mondain, ces huit contes sombrent dans l’oubli.
Ce n’est que vers la seconde moitié du XIXe siècle que Les Contes de ma mère l’Oyerenouent avec la faveur des lecteurs, notamment avec l’édition illustrée par Gustave Doré, en 1861. Cependant, le texte a été remanié, la langue ayant trop évolué. Ainsi, les termes surannés se trouvent expliqués dans des notes en bas de page, mais aussi des personnages ou des détails ont été supprimés, ainsi que certaines « moralités », modifiées.
Une nouvelle adaptation est publiée en 1902, réalisée par Féron et calquée sur la précédente. Et, depuis, aucune autre. C’est désormais la version la plus commune en librairie.
Mais, cent vingt ans plus tard, la langue a de nouveau considérablement vieilli. Elle reste belle, agréable, mais aussi désuète, un peu lourde, parfois obscure. Elle n’est plus tout à fait la nôtre. Cette ancienneté ne la rend pas illisible pour un lecteur aguerri. Mais pour les autres ? Jeunes lecteurs. Parents et grands-parents en faisant la lecture, mais ne comprenant pas eux-mêmes un mot, une phrase, une allusion dont on leur réclame l’explication. Étrangers explorant ce singulier français.
D’ailleurs, à l’école, les études de texte qui en sont proposées s’attardent volontiers sur leurs tournures démodées et le vocabulaire obsolète. En privilégiant ainsi l’archéologie littéraire, cette approche laisse le souvenir très scolaire d’un texte peu engageant, d’un français difficile, réservé à d’autres, et de peu d’intérêt. Or, l’enjeu de ces contes n’est pas linguistique, leur lecture doit se faire au profit du sens.
Ces contes, Perrault ne les a pas inventés, il les a recueillis. S’il avait cité ses sources, il aurait été considéré comme le tout premier collecteur de traditions orales, bien que d’autres, avant lui, avaient transcrit certaines de ces histoires. Perrault a fixé, pour une classe plus bourgeoise que populaire, les contes que les mères-grands (ou l’emblématique mère l’Oye) racontaient aux enfants, ou qui se disaient lors des veillées. Et ses moralités en proposaient son interprétation, à la manière dont La Fontaine concluait ses Fables.
Ce recueil, à son tour, a formé la matière de la transmission des contes de fées, s’ouvrant à un public plus large. Ces textes ne sont pas pour autant figés. Ils ne constituent pas une fin, mais une invitation. La base d’une réflexion, l’occasion d’un débat, d’un dialogue lorsqu’ils sont lus aux enfants. Les jeunes lecteurs doivent être accompagnés dans la découverte des contes de fées, car l’apprentissage de la lecture ne se résume pas à décrypter des signes, mais bien à comprendre, à se construire.
La valeur des Contes de ma mère l’Oye n’est pas dans le divertissement.
Aussi, quand Hollywood pille notre patrimoine littéraire et le dénature pour le plier aux exigences de son commerce, il y a urgence à se souvenir que ces histoires sont l’héritage d’une longue tradition. Que ces contes de fées sont ancrés dans notre imaginaire collectif. Qu’ils sont indispensables à notre éveil, à l’apprentissage du monde et à la domestication de nos peurs.
Un seul exemple : en première lecture, il est tentant de déduire que Le Petit Chaperon rouge n’est qu’une mise en garde des jeunes filles envers les beaux parleurs. Et la fin heureuse des frères Grimm renforce cette perspective affadie. Pas dans le conte rapporté par Perrault, sa morale est sans équivoque. Avec lui, c’est le Loup qui gagne et qui s’en tire sans dommages, après avoir, littéralement, mené la jeune ingénue dans son lit, mais aussi après avoir tué sa grand-mère. Transposons ce conte en nous inspirant d’un sujet contemporain : le fanatisme, qu’il soit politique ou religieux. C’est bien d’endoctrinement dont il est question. Ce conte est nécessaire, car il s’adresse à tout jeune (« peu instruit encore des ruses de ce monde », insiste-t-il dans Le Chat botté), le plus tôt possible, pour le mettre en garde contre la docilité adolescente à épouser les thèses nouvelles, son aspiration naturelle à suivre son propre chemin, à considérer comme vérité toute découverte, à se laisser duper jusqu’à provoquer le malheur autour de soi.
En transcrivant des contes, Perrault a d’abord procédé à des regroupements, des arrangements. Ensuite, à plusieurs reprises, il est revenu sur son propre manuscrit pour l’alléger. Il a ôté des références à d’autres histoires, des détails superflus. Il aurait pu poursuivre dans cette voie, par exemple en modifiant le titre du conte Les Fées, puisqu’il n’en a conservé qu’une.
J’ai entrepris de les réécrire une première fois pour les enfants qui ont du mal à lire, selon des critères spécifiques aux difficultés d’apprentissage de la lecture. Après avoir ainsi déconstruit puis reconstruit plusieurs contes populaires, je me suis demandé ce qu’il adviendrait de ces jeunes lecteurs lorsqu’ils ouvriraient un « vrai » livre, à la recherche d’un autre conte de fées… L’écart m’a semblé tel que j’ai redouté qu’il les dissuade de persévérer. Il devenait urgent de dépoussiérer ces textes.
Je n’ai rien ajouté, j’ai usé d’analogies, j’ai préservé autant que possible le style classique, je n’ai supprimé que quelques termes ou simplifié des tournures complexes qui faisaient obstacle au plaisir de lire. Je n’ai pas déplacé ou remplacé un mot, corrigé les temps, ôté ou inséré une virgule sans me demander si c’était justifié, pertinent, vraiment nécessaire, si je restais fidèle à Perrault.
Cette démarche, je l’ai également appliquée à certains détails du texte, qui se rapportaient soit à des incohérences (la marraine de Cendrillon transforme la citrouille en carrosse dans la chambre de Cendrillon, située au grenier ; certains illustrateurs ont respecté cette instruction, quitte à représenter un carrosse miniature), ou encore des précisions inutiles (que nous apporte d’apprendre soudain qu’un frère du petit Poucet se nomme Pierrot et qu’il est « un peu rousseau » comme sa mère, informations étrangères à l’intrigue ?), voire d’une époque révolue (nos cuisiniers, même les plus élégants, ne portent plus une peau de bête sur la tête, en en laissant pendre la queue sur leur épaule, comme indiqué dans Riquet à la houppe).
En revanche, j’ai réintégré des éléments disparus lors de la dernière révision de ce recueil (comme la présence de la princesse dans le carrosse du Chat botté, ou les échanges de la princesse et du prince dans La Belle au bois dormant).
Et j’ai rétabli les morales.
Après ces remaniements, qui connaît bien Les Contes de ma mère l’Oye ne devrait pas être dépaysé. Mais ce n’est pas pour eux que j’ai osé cette actualisation.
L’imaginaire littéraire est un arbre charmant aux ramages fluctuants, mais l’arbre dépérit si l’on néglige ses racines. Si j’ai souhaité rendre ces contes de fées accessibles au plus grand nombre, c’est afin de restituer pleinement la force qui leur a permis de traverser le temps, cet élément essentiel qui nous touche intimement et qui est aussi l’âme de la littérature : la magie de l’émerveillement.
Jean-Claude Marguerite